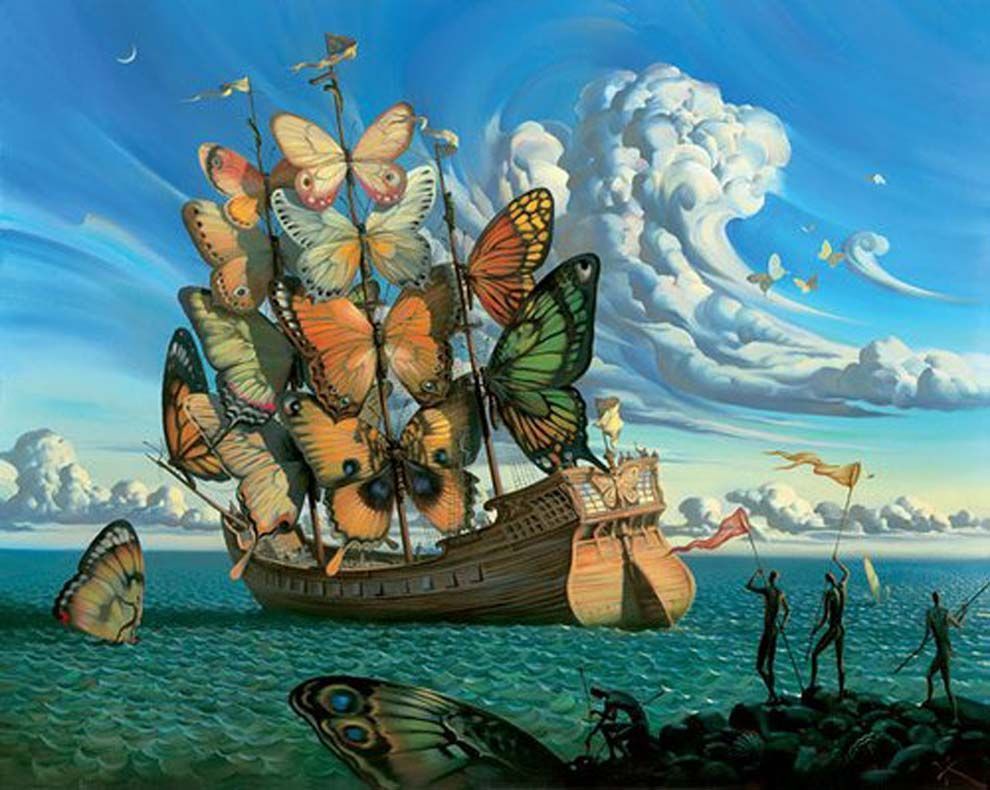A l’approche des journées du patrimoine des 15 et 16 septembre prochains, nous enjoignons les inconditionnels du Marais à aller découvrir les deux somptueuses restaurations de deux bâtiments emblématiques du Marais que sont l’Hôtel de Mayenne et l’église Saint Paul-Saint Louis.
L’Hôtel de Mayenne

Dans un article de Vivre le Marais du 19 février 2012 (voir aussi un article antérieur du 19 novembre 2011), nous indiquions que les travaux de restauration de l’Hôtel de Mayenne, annoncés en novembre 2009 (21, rue Saint Antoine), classé à l’IMH depuis 1974, étaient enfin lancés.
Deux ans et demi se sont écoulés et nous retrouvons, alors que des bâches le recouvraient jusqu’à peu de temps, un bâtiment remarquable avec tout son lustre d’origine, ce qui en fait un digne pendant de l’Hôtel de Sully, son proche congénère. Pourtant la partie n’était pas gagnée entre les tenants du maintien du pastiche du XIXème siècle (dit parfois « le bouchon ») qui reliait les deux ailes (la Commission de Vieux Paris) et ceux qui souhaitaient sa suppression de façon à redonner à l’ensemble son aspect d’origine (le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine).
Le résultat admirable est à la hauteur des enjeux. En effet, nous découvrons, exception faite des constructions de la place de Vosges, un rare exemple d’un hôtel parisien construit en pierre et en brique, dans le style tout à fait caractéristique de la fin du règne d’Henri IV et du début de celui de Louis XIII. Outre la restitution des deux ailes, les opérations ont permis de mettre à jour les deux murs latéraux des avant corps, les deux fenêtres et les deux lucarnes avec toutes les moulures et les sculptures d’origine. Quant au portail, à son revers a été redécouvert le balconnet porté par des consoles sculptées de qualité exceptionnelle. Lorsque le visiteur pénètre à gauche dans la cour, il peut admirer l’ancienne galerie à arcade ouvrant sur l’escalier d’honneur montant à l’étage. A droite, il trouve une intéressante tourelle sur trompe (c’est-à-dire supportée par une portion de voûte tronquée) du début du XVIème siècle.

Balconnet porté par des consoles sculptées
Si nous faisons un bref rappel historique, nous apprenons que l’Hôtel a appartenu au petit fils de Saint Louis ainsi qu’à Charles VI (dès 1398). Suite à un duel, un des « mignons » d’Henri III mourut devant la façade principale. Alors dénommé Hôtel de Boissy, c’est de 1567 à 1569 que sont construits le logis et les ailes. Après avoir été la propriété des évêques de Langres, cet ensemble est acheté en 1605 par Charles de Lorraine, duc de Mayenne. Des transformations importantes sont opérées de 1613 à 1617, le nom actuel d’Hôtel de Mayenne date de cette époque, de même d’ailleurs que les croix de Lorraine qui ornent les ferronneries des balcons. Au début du XVIII ème siècle, des travaux d’embellissement sont confiés à Germain Boffrand un des principaux collaborateurs de Jean Hardouin-Mansart avec lequel il participe notamment à l’aménagement de la place Vendôme, du Palais Bourbon et de l’Orangerie du Palais de Versailles. Nous devons aussi à Boffrand l’introduction du style rocaille en France et l’important château de Lunéville. Durant la Révolution l’Hôtel est habité par Le Fèvre d’Ormesson qui commande une section de la Garde Nationale Après avoir été vendu, l’Hôtel de Mayenne est transformé en 1870 en maison d’éducation des Frères des Ecoles Chrétiennes, sa destination n’a pas changé depuis lors.
La qualité des travaux de restauration effectués est remarquable et nous voyons sous un autre jour, dans son style originel, cette magnifique bâtisse, un atout certain pour notre quartier.
L’église Saint Paul-Saint Louis

Après 14 mois de travaux, le voile s’est progressivement levé sur la restauration très réussie de l’église Saint Paul-Saint Louis (99, rue Saint Antoine) dont l’imposante façade a été magnifiquement refaite, de même que les emmarchements et les retours latéraux. Les pierres abîmées ont été remplacées, ainsi que les statues et les décors sculptés qui, selon leur état, ont été consolidés ou ragrés. Le nettoyage, l’enlèvement des réparations anciennes en ciment et en béton, ont rendu sa splendeur à l’édifice dont l’éclat est rehaussé par la restauration du vitrail de la façade et de la grande horloge (elle provient de l’église saint Paul des Champs aujourd’hui détruite) éclatante en or et bleu. L’édifice dont le nom originel était "Saint Louis de la maison professe des jésuites" a été construit par deux architectes jésuites sur ordre de Louis XIII, sur les deniers personnels de Richelieu qui posa la première pierre en 1634 et y célébra la première messe, 7 ans plus tard, le jour de l’Ascension.

La grande horloge
La construction est influencée par l’Italie et les traditions françaises. Ainsi la façade peut être qualifiée d’italienne dans son aspect mais sa verticalité montre aussi qu’elle est d’inspiration gothique. Toutefois chacun s’accorde à dire qu’elle est de « style jésuite » par son plan en croix latine et sa nef bordée de chapelles. Sa coupole dont l’aspect rappelle celles des Invalides et du Val de Grâce culmine à 55 mètres !
En 1762, les jésuites sont remplacés par les chanoines d’un autre ordre par décision du Parlement de Paris qui supprime la Société de Jésus. Endommagée à la Révolution qui voit mourir dans ses murs 5 prêtres tués lors des massacres de septembre 1792, l’église est alors dédiée au culte de la Raison. Ce n’est qu’en 1802 que le culte catholique est rétabli sous l’appellation d’église Saint Paul-Saint Louis. Au cours du Second Empire, sous la direction de Baltard, la façade subit une restauration. L’ensemble est classé monument historique en 1887.
Le mobilier de l’église est particulièrement riche. Les œuvres les plus rares sont la statue dite « La Vierge douloureuse » commandée par Catherine de Médicis à Germain Pilon dont on retrouve les principales œuvres au Louvre. Un très beau tableau intitulé « Le Christ en agonie au jardin des oliviers » est l’œuvre de Delacroix. Les 2 coquilles qui servent de bénitiers de chaque côté du portail principal de la façade sont un don de Victor Hugo à l’occasion du mariage de sa fille Léopoldine, en 1843. Le maître autel a été refait sous Louis Philippe et utilise du marbre blanc provenant de surplus de la galerie circulaire du tombeau de Napoléon. De riches reliquaires et mausolées contenant des cœurs embaumés, en particulier ceux de Louis XIII, de Louis XIV et du Grand Condé ont malheureusement disparu durant la Révolution. Quant au grand orgue, il remplace celui qui a été enlevé à la Révolution et sur lequel ont joué Marchand, Rameau et Corette. L’instrument actuel date de 1871 et son importance lui valut d’être reçu par deux grands maîtres, César Franck et Théodore Dubois. Sa dernière restauration date de 2005.
N’oublions pas les autres personnages célèbres qui ont fréquenté ce lieu. Citons plus particulièrement Madame de Sévigné qui venait écouter assidument les sermons de Bourdaloue. Bossuet prononça aussi à cet endroit des oraisons. Enfin, il faut signaler que la crypte de l’église abrite de nombreuses sépultures de jésuites et laïcs dont celle de Bourdaloue.
Vraiment la renaissance de ces deux lieux chargés d’histoire est un événement qui mérite le détour!
Dominique Feutry
 "Le nourrisseur" en action au Quartier de l'Horloge
"Le nourrisseur" en action au Quartier de l'Horloge