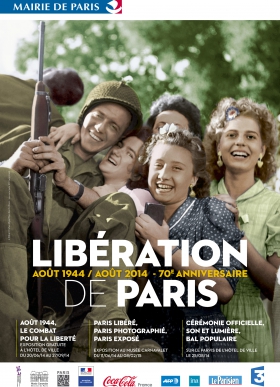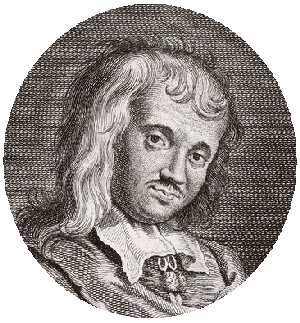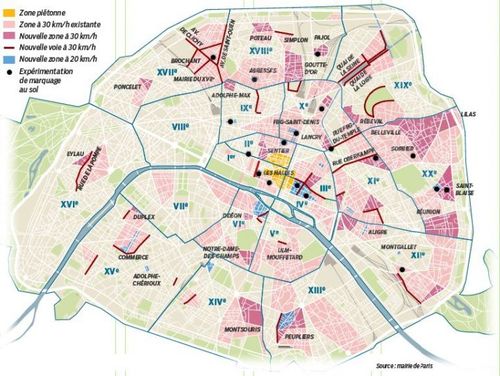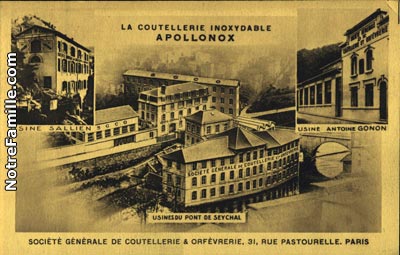La cour de l'Hôtel d'Albret (IVe)
La cour de l'Hôtel d'Albret (IVe)
L’Hôtel d’Albret (IVe) dont nous avons parlé dans deux récents articles (21 mai et 1er juillet 2014) abrite du 18 au 30 août un festival de musique organisé en partenariat avec France Musique, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et la SACEM.
Chaque jour (sauf les samedis et dimanches) un concert public gratuit est proposé à 18h00 dans la cour de l’Hôtel. Il s’agit de rendez-vous éclectique qui réunit des artistes venant de différents pays et des musiques aussi variées que la musique classique le jazz ou la chanson.
Ces concerts sont une des facettes de festivals d’été organisés dans la capitale (Théâtre du Châtelet, le Théâtre de la Ville…). En effet la municipalité s’est également engagée auprès de réseaux et de structures d’accompagnement de professionnels de la musique auxquels elle apporte des aides ainsi qu’à plus de 20 ensembles vocaux et instrumentaux (quatre ensembles vocaux et plus de 15 orchestres et ensembles instrumentaux dont l’Orchestre de Paris et l’Orchestre de Chambre de Paris). Pour les amateurs les choix sont donc multiples.
Les nombreux artistes et les ensembles invités (Spirit of Chicago Orchestra, Les Anches Hantées…) sont de grande qualité. Nous vous conseillons de prendre connaissance quotidiennement du programme sur le site de France Musique qui procède d’ailleurs à une diffusion en direct des concerts à l’affiche.
Voilà une occasion de redonner un vrai sens à la musique de plus en plus dévoyée lors de la fête du même nom en juin.
HOTEL D’ALBRET, 31 rue des Francs-Bourgeois (IVe).